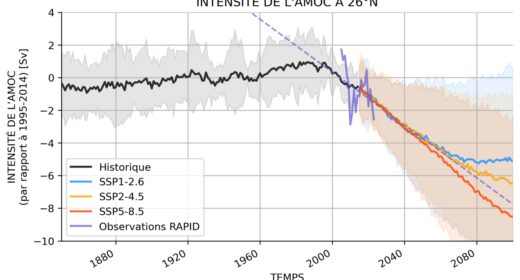L’impact du changement climatique sur la santé humaine est largement documenté par la communauté scientifique, qui reconnaît la crise climatique comme « la plus grande menace sanitaire planétaire à laquelle le monde est confronté au XXIe siècle, mais aussi la plus grande opportunité de redéfinir les déterminants sociaux et environnementaux de la santé » 1 2. Parmi les 47 indicateurs de santé publique suivis par le Lancet Countdown3 depuis 2015, plusieurs, tels que les rendements des cultures, la sécurité alimentaire ou la disponibilité de l’eau pour l’irrigation, témoignent de l’importance de l’agriculture dans les impacts sanitaires liés au changement climatique.
Le changement climatique, un amplificateur des impacts environnementaux et sanitaires de l’agriculture
Le changement climatique ne constitue pas seulement un risque spécifique, mais c’est aussi un amplificateur d’autres risques. Les modifications des conditions climatiques moyennes et la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes provoquent des effets en cascade qui affectent directement ou indirectement toutes les composantes de l’environnement et de la santé (humaine, animale, végétale). L’ampleur et les types de risques sanitaires sont conditionnés par de nombreux processus environnementaux, socio-économiques et politiques complexes dont beaucoup sont largement influencés par l’agriculture, à travers ses différentes politiques et types de pratiques4 . Ainsi, certains risques sanitaires générés par l’agriculture comme les risques liés à l’usage des pesticides peuvent être exacerbés par le changement climatique.
Un récent travail (Yang et al. 2024)5 témoigne de la manière dont le changement climatique est susceptible d’amplifier les impacts environnementaux de l’agriculture. Ces travaux aboutissent à deux conclusions majeures (Figure 1 partie A). Premièrement, le changement climatique aggravera probablement certains facteurs qui nuisent déjà directement à la productivité agricole, par exemple en réduisant l’efficacité des produits agrochimiques, en augmentant leur perte dans l’environnement, en augmentant la pression des ravageurs des cultures, ou en favorisant l’érosion des sols. Deuxièmement, la réponse de l’agriculture au changement climatique pourrait créer une boucle de rétroaction positive, augmentant par de multiples voies les émissions de GES du secteur (déjà un cinquième des émissions mondiales). Par exemple, une réduction des émissions liées à l’élevage pourrait être contrebalancée par des augmentations dans d’autres secteurs, si plus de produits agrochimiques sont utilisés pour compenser leur perte d’efficacité ; si des conditions plus sèches nécessitent une irrigation plus énergivore et intensive en carbone ; ou si des pertes accrues de nutriments amplifient les émissions biogéniques de GES dans les systèmes aquatiques.
Figure 1 : Risques sanitaires liés aux impacts environnementaux de l’agriculture dans un contexte de changement climatique. Réalisation HCBC.
La santé des agriculteurs directement impactée
La partie A de la figure 1, reprise de Yang et al. (2024), a été complétée (partie B) avec l’objectif d’identifier l’ensemble des impacts sanitaires potentiels liés aux systèmes agricoles en adoptant une approche systémique et sur la base de synthèse des connaissances disponibles 6 7 8. Elle permet d’illustrer la large gamme d’impacts sanitaires potentiels, directs et indirects, via différentes voies d’exposition et mécanismes d’action, influencés par les pratiques agricoles (cultures et élevages) dans un contexte de changement climatique. Pour interpréter la figure, quelques exemples de mécanismes conduisant aux impacts sur la santé sont explicités ci-après.
Les impacts directs, résultant des modifications des caractéristiques climatiques et/ou des évènements climatiques extrêmes à court terme, affectent la santé humaine, notamment celle des agriculteurs9. Ils se traduisent, notamment, par l’augmentation des blessures et des décès dus aux événements extrêmes et l’augmentation des maladies liées à la chaleur. Les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses, augmentent les risques de coups de chaleur, de déshydratation, d’aggravation des maladies cardiovasculaires et respiratoires pouvant aller jusqu’au décès. L’intensification des évènements climatiques extrêmes (tempête, inondations etc.) peut également entraîner des troubles de la santé mentale, comme l’anxiété, la dépression et un stress post-traumatique.
De multiples impacts indirects sur la santé des populations
Les impacts indirects liés aux pratiques agricoles résultent d’une chaîne de conséquences impliquant divers facteurs environnementaux et socio-économiques. Par exemple, les sécheresses et les inondations peuvent affecter la production agricole et la disponibilité en eau10, augmentant ainsi le risque de maladies liées à l’insécurité alimentaire et hydrique. La dégradation des écosystèmes, exacerbée par les pratiques agricoles (perte de biodiversité due à l’arasement des haies, dégradation et artificialisation des sols, etc.), peut modifier les habitats et le cycle de développement des vecteurs de maladies (moustiques, tiques, etc.), et accroître la propagation de maladies vectorielles (dengue, maladie de Lyme, etc.)11. De même, l’augmentation de la pollution des écosystèmes aquatiques, terrestres et aériens par les produits agrochimiques (pesticides et engrais) accroît le risque de maladies infectieuses et d’intoxications alimentaires via la consommation d’aliments ou d’eau contaminés. La raréfaction des plans d’eau induite par les sécheresses et la concentration de l’avifaune sauvage sur les quelques plans d’eau restants est un facteur de propagation connu des épidémies de grippe aviaire qui peuvent ensuite se propager aux élevages domestiques. De plus, l’augmentation des concentrations de dioxyde de carbone a des effets néfastes sur la qualité nutritionnelle des principales cultures céréalières, telles que le riz et le blé, en réduisant notamment les niveaux de protéines, de micronutriments et de vitamines. Le risque accru de zoonoses peut s’expliquer par différents mécanismes conduisant à une promiscuité accrue entre animaux sauvages et animaux d’élevage et/ou humains. Enfin, soulignons l’importance du rôle clé de nombreux facteurs socio-économiques (accès à une assurance, pression sociale au changement, intensification du travail, perte de revenus, etc.) en tant que facteurs majeurs qui influencent la gravité des impacts sur la santé physique et mentale des agriculteurs12 et de leurs familles.

Traitement charancon
Photo 1 : Traitement insecticide contre le charançon du colza © AdobeStock
Mobiliser le concept « One Health »
Ces dernières années, une prise de conscience généralisée des interconnexions étroites et complexes entre les différents types de santé (humaine, animale domestique et sauvage, environnementale, végétale) s’est imposée et a conduit à l’élaboration du cadre conceptuel « One Health13 » (une seule santé) pour soutenir des approches intégrées et unificatrices de ces santés. On pense à la crise du COVID dont l’émergence a été attribuée, notamment, à l’accroissement des risques de transfert de pathogènes de la faune sauvage aux humains, lié à la détérioration de l’environnement naturel, mais également aux habitudes alimentaires et à l’organisation des modes de commercialisation. On peut également mentionner la menace que fait peser sur les élevages bretons la récurrence d’apparition de foyers de grippe aviaire, dont les populations d’oiseaux sauvages constituent le réservoir14 et qui posent des questions quant aux modes de gestion des populations sauvages et à l’organisation des systèmes d’élevage avec des conséquences potentiellement majeures sur la santé économique des exploitations et la santé mentale des exploitants. On rappellera, par ailleurs, que les pandémies humaines de grippe résultent généralement d’échange entre des souches humaines, porcines et aviaires15.
La complexité de ces interactions requiert leur appréhension simultanée par des spécialistes originaires de nombreuses disciplines (médecins, vétérinaires, écologues, généticiens, agronomes, économistes, sociologues, psychologues, …). À l’évidence, le monde agricole est un domaine particulier dans lequel s’expriment de nombreuses interfaces (économie/société, nature/culture, domestique/sauvage, environnement naturel/anthropisé, terrestre/aquatique, etc.), toutes fortement impactées par le climat et son évolution, avec des conséquences potentiellement majeures sur les différents types de santé, et singulièrement la santé humaine. Il est crucial, pour une région fortement agricole comme la Bretagne, de rester attentive aux conséquences éventuelles sur la santé du changement climatique en cours, par une approche pluridisciplinaire et intersectorielle, telle que proposée par le concept One Health.
Titre : Agriculture et changement climatique : des défis pour la santé humaine
Auteur : Haut Conseil Breton pour le Climat
Année de publication : 2025
Type : Rapport
Citation : HAUT CONSEIL BRETON POUR LE CLIMAT, 2025, « Agriculture et changement climatique : des défis pour la santé humaine », Bulletin annuel 2025, p. 18-21
- Romanello et al., https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01859-7/abstract ↩︎
- Pan American Health Organisation Web. 28 Jan. 2025 https://www.paho.org/en/topics/climate-change-and-health ↩︎
- Lancet Countdown. « Lancet Countdown on Health and Climate Change Web ». 4 Dec. 2024. https://www.lancetcountdown.org ↩︎
- Haines et Ebi, 2019 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1807873 ↩︎
- Yang et al., 2024 https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn3747 ↩︎
- Owino et al., 2022 https://www.frontiersin.org/journals/climate/articles/10.3389/fclim.2022.941842/full ↩︎
- Ebi et al., 2018 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aac4bd ↩︎
- Hawkes et Ruel, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17242835/ ↩︎
- El Khayat et al., 2022 https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2022.782811/full ↩︎
- Lesk et al., 2016 https://www.nature.com/articles/nature16467 ↩︎
- Skinner et al., 2023 DOI:10.1038/s41893-023-01080-1 ↩︎
- Berry et al., 2011 DOI: 10.1177/1010539510392556 ↩︎
- One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP) et al., 2023 https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1010537 ↩︎
- https://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Actus/Influenza-aviaire-Extension-de-la-zone-de-protection-et-de-surveillance-en-Morbihan-2-nov.-2024#:~:text=Un%20nouveau%20foyer%20d’influenza,origine%20probable%20de%20la%20contamination ↩︎
- Zimmer et Burke, 2009 DOI: 10.1056/NEJMra0904322 ↩︎