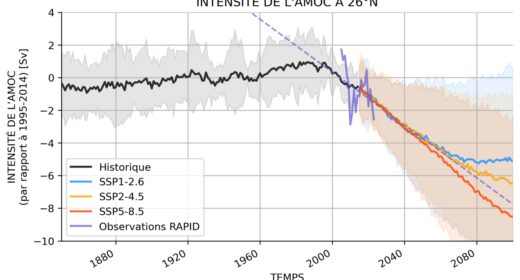L’agriculture est une actrice majeure du territoire, qui organise l’espace en fonction des potentialités du milieu (sol, relief, microclimat) et des choix technico-économiques des exploitants agricoles. A l’échelle locale, les parcelles forment des espaces fonctionnels et structurels qui servent de supports à la production. Aux niveaux supérieurs (terroir, micro-région, paysage, territoire), la mosaïque de ce parcellaire et des espaces interstitiels (dont les bords de parcelles) influence de nombreux processus biogéophysiques et écologiques. Les exploitants gèrent leurs parcelles et aménagements pour assurer leurs différentes productions, souvent en rotation, et des fonctions agroécologiques. La perception sensible par l’homme de cette mosaïque et des services écosystémiques rendus correspond aux aménités paysagères, très liées aux valeurs patrimoniales.
Vers une gestion intégrée du territoire
Les dynamiques influencées par les pratiques et la mosaïque agricoles sont nombreuses, avec des effets de circulation, de réservoir et de transformation. Il en va ainsi de l’eau et des matières qu’elle transporte (matériaux d’érosion et de sédimentation, éléments chimiques naturels et artificiels…) ; de l’air, réceptacle et vecteur des émissions gazeuses et des aérosols ; d’agents biologiques (éléments de biodiversité, incluant les auxiliaires et ravageurs de cultures). La météorologie locale (et donc le climat local) est également très influencée par la composition et la rugosité de cette mosaïque, déterminant localement une partie des précipitations et de l’évapotranspiration, la genèse des écoulements et de l’érosion, l’alimentation des sols et des zones humides, le confort des animaux. En cas d’événement extrême (tempête, pluie-humidité-crue, sécheresse, canicule, incendie, attaque sanitaire…), l’organisation de la mosaïque (diversité, densité, orientation, connectivité) détermine la vulnérabilité, la robustesse et la résilience de l’ensemble productif et environnemental.
Les effets des aménagements et des pratiques sont nombreux et interconnectés, parfois explicites et recherchés, parfois méconnus, implicites et/ou négligés ; d’autant qu’ils émergent aux échelles paysagère et territoriale qui agrègent plusieurs exploitations agricoles dont les parcelles sont souvent disjointes, et d’autres emprises. Compte tenu des effets à venir du changement climatique, les agriculteurs doivent pouvoir activer des leviers paysagers et territoriaux pour améliorer leurs capacités d’adaptation. En outre, des évolutions ont émergé, telles que la production de cultures énergétiques ou supports de méthanisation, l’implantation de panneaux solaires au sol et sur les toits de bâtiments agricoles, la construction de retenues de substitution pour sécuriser l’approvisionnement hydrique des cultures par irrigation, la perte de terres agricoles par (péri-)urbanisation. Ces tendances questionnent le nexus agriculture-eau-énergie, la destination du foncier agricole et la gestion intégrée de l’eau avec de fortes controverses socio-techniques. Les enjeux de l’adaptation demandent l’élaboration d’un nouveau paradigme régional, alimenté par des études scientifiques1 2, décliné en politiques publiques, et au service de la sécurisation d’une agriculture raisonnée et robuste ; et non pas d’une course à la sur-intensification assortie d’effets rebond et de paradoxes3 4.
Cela oblige à envisager des horizons de transformation à moyen et long termes, accompagnés de fortes incertitudes, et à chercher des mesures systémiques et synergiques avec les autres enjeux de transformation. Par ailleurs, la société attend des agriculteurs qu’ils assurent des services en plus de la production, au titre de la multifonctionnalité5. Cela implique un nouveau contrat de société qui s’appuie sur une reconnaissance des efforts et des coûts induits par cette multifonctionnalité, au-delà des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) actuelles, ainsi que sur des arbitrages forts. Face à la complexité agro-écolo-climatique et à son évolution à venir, la connaissance est incomplète mais les pistes peuvent être déduites de la rétrospective bretonne, des recherches en cours, de territoires pionniers et d’expériences étrangères.
Une redécouverte des vertus du bocage
Au cours de l’histoire bretonne, les remembrements, débocagements, drainages et recalibrages qui ont accompagné l’intensification de la production agricole post 1945 ont eu de nombreux effets pervers. Une dynamique est à l’œuvre depuis la fin des années 1990 qui associe des changements de pratiques et des SFN – Solutions Fondées sur la Nature (protection et restauration des sols, des zones humides et du bocage) avec des objectifs de reconquête de la qualité de l’eau, de ralentissement des écoulements, et de facilitation d’interactions agroécologiques6. La transformation vertueuse est profonde au sein de nombreuses exploitations, allant de l’adoption de pratiques moins intensives à la conversion biologique et l’expérimentation de pratiques agroécologiques. Mais l’absence de transformation généralisée et l’inertie de certains processus biogéophysiques limitent les effets positifs émergents aux niveaux agrégés. Les effets visés sont globalement en synergie avec l’adaptation au changement climatique, et donc ces efforts doivent être amplifiés, avec d’éventuels ajustements (e.g. organisation géométrique des structures, choix des essences…) afin de contribuer à tamponner la variabilité et les extrêmes météorologiques ainsi que des processus météo-dépendants dont la dynamique de certaines maladies, l’intermittence et la connexion-déconnexion de certains compartiments hydrologiques7 qui parfois intensifient l’émission de polluants aquatiques et atmosphériques8.

Photo 1 : Paysage bocager breton, © M Cudennec
L’objectivation et la perception du changement climatique sont plus tardives en Bretagne que dans d’autres régions. Des travaux de recherche-développement en agronomie territoriale sont en cours et les premiers résultats confirment l’intérêt des (infra-)structures paysagères, de la diversification intra- et inter-parcelles et des décalages de semis. Ces niveaux d’action emboîtés permettent de jouer sur la complémentarité des parcelles ; sur le redimensionnement des exploitations en accord avec leurs ressources9 ; sur des associations agroforestières pour tamponner les processus en années contrastées10 ; sur le stockage de carbone et la teneur en eau dans les sols11.
Des exemples inspirants
L’accompagnement des transformations agricoles, pour gagner en robustesse et en résilience face au changement climatique dans une perspective paysagère et territoriale, passe par l’identification de systèmes cohérents et l’orchestration des actions avec le jeu d’acteurs ad hoc. Certains bassins versants ont fait l’objet de plans d’actions agricoles ambitieux dont il faut tirer les leçons, en particulier en termes d’organisation des pratiques selon leur intensification (“land sparing vs. land sharing”12). Les PNRs – Parcs Naturels Régionaux associent les porteurs d’enjeux, comme le nouveau PNR Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude avec l’arboriculture qui oblige à se projeter vers un horizon lointain fortement impacté par le changement climatique. De même, les îles sont des systèmes bien délimités, sentinelles du changement climatique, et les enjeux agricoles y sont appréhendés par une recherche participative régionale (ENEZBZH) portée par le RAIA – Réseau Agricole des Îles de l’Atlantique. De nouvelles pratiques pédagogiques de l’enseignement agricole permettent quant à elles de développer des compétences intégrées à travers des projets territoriaux et des observatoires. Dans toutes ces régions, le paysage agricole participe à une certaine identité régionale, un patrimoine souvent valorisé sur le plan touristique et dont le maintien est aujourd’hui questionné par le changement climatique.
Des exemples étrangers méritent par ailleurs d’être examinés, en particulier lorsqu’ils concernent des climats et secteurs agricoles comparables à ceux de la Bretagne. L’Irlande travaille actuellement à renforcer sa coordination de l’ensemble du secteur agri-alimentaire en tant que démonstrateur du partenariat européen KIC-Climat13. Le Danemark vient, quant à lui, de promulguer une loi très ambitieuse qui crée une taxe carbone sur l’élevage, dans le but d’encourager les exploitations à se transformer avec réduction des émissions de méthane et d’azote, et de réinvestir dans la transformation de 10% de la surface agricole nationale en forêts. L’inspiration doit aussi être recherchée dans des expériences d’adaptation plus au Sud, sous des climats qui peuvent ressembler au futur climat breton, en particulier lorsqu’une similitude de milieu physique permet de regarder en détail les relations entre mosaïque agricole et climat.
Titre : Agriculture, paysage et territoire
Auteur : Haut Conseil Breton pour le Climat
Année de publication : 2025
Type : Rapport
Citation : HAUT CONSEIL BRETON POUR LE CLIMAT, 2025, « Agriculture, paysage et territoire », Bulletin annuel 2025, p. 15-17
- Richard et al., 2018, https://www.quae-open.com/produit/103/9782759229383/une-agronomie-pour-le-xxie-siecle ↩︎
- Carof et al., 2022, 10.1016/j.scitotenv.2022.156022 ↩︎
- Di Baldassare et al., 2019, 10.1029/2018WR02390 ↩︎
- Godinot et al., 2024, 10.1016/j.agsy.2024.104137 ↩︎
- Le Caro, 2015, https://univ-rennes2.hal.science/hal-01580764v1 ↩︎
- Caquet et al., 2020, https://www.quae.com/produit/1620/9782759231300/agroecologie-des-recherches-pour-la-transition-des-filieres-et-des-territoires ↩︎
- Fovet et al., 2021, https://doi.org/10.1002/wat2.15https://doi.org/10.1002/wat2.1523 ↩︎
- Dupas et al., 2024, https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122108; Bedos et al., 2019, 10.35690/978-2-7592-2938-3 ↩︎
- Réseau CIVAM et Réseau Action Climat, 2023, https://www.civam.org/ressources/reseau-civam/agriculture-durable-thematique/rapport-resilience-de-lagroecologie-face-aux-crises-economiques-et-climatiques/ ↩︎
- Mettauer et al., 2024, https://doi.org/10.1186/s13717-024-00538-0 ↩︎
- Lesaint et al., 2023, https://doi.org/10.1111/sum.12928 ; Soltani et al., 2019, https://doi.org/10.1111/ejss.12725 ↩︎
- Desquilbet et al., 2013, https://doi.org/10.17180/qmd6-2b60 ↩︎
- https://www.climate-kic.org/sustainablefoodireland/ ↩︎