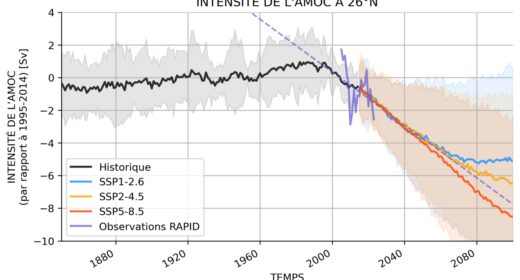La transformation agricole face au changement climatique ne relève pas de la seule évolution des pratiques des agriculteurs : elle concerne tout le système de production dans lequel ils s’insèrent et la chaîne de création de valeur qui s’étend du champ à l’assiette. Déterminés par une histoire spécifique à la Bretagne, le modèle agricole breton et sa gouvernance reposent sur des relations entre acteurs économiques, sociaux et politiques à l’origine d’inerties et de verrous, qu’il faut analyser et lever à l’heure de crises climatiques et écologiques globales dont les effets se font ressentir au plan local.
L’enjeu des décennies à venir est d’opérer une transition structurelle vers une agriculture moins émettrice (décarbonation) et plus robuste face aux changements et aux extrêmes climatiques (adaptation). Cette série complexe d’évolutions suppose des changements de pratiques, d’habitudes, de représentations et de fonctionnements institutionnels qui concernent plusieurs niveaux enchâssés : les agriculteurs et agricultrices, l’exploitation agricole, la filière de production des denrées animales ou végétales, et plus largement la chaîne de création de valeur incluant les activités de transformation des produits et de distribution des biens de consommation. Ces différents niveaux interagissant, il y a nécessité, pour être à la hauteur des changements, d’opérer des actions structurelles, allant au-delà des évolutions individuelles ou de l’expérimentation de pratiques alternatives. Un diagnostic des verrous à la fois socio-techniques et systémiques est donc indispensable avant d’examiner les trajectoires de transformation envisageables.
Forces et inerties du modèle agricole breton
Les verrous propres au système agri-alimentaire breton trouvent leur origine dans ce qui a aussi fait son succès initial, en tant que modèle agricole1 qui émerge dans le sillage du plan Marshall (1958) et se stabilise à la fin des années 1970. A l’image d’autres types d’agriculture intensive (le modèle céréalier de la Beauce, l’agriculture irriguée dans le sud-Ouest), ce modèle repose sur l’insertion des exploitations à base familiale dans l’économie de marché et le capitalisme industriel, avec pour conséquence une exigence de rationalisation de la production, le recours à la mécanisation, à des variétés et races améliorées, la nécessité d’apports croissants d’intrants (pesticides, fertilisants chimiques, énergie). Ce processus d’intensification et d’industrialisation va de pair avec une spécialisation, un accroissement de la taille des exploitations et une réduction de la population agricole.
Un deuxième trait spécifique est l’organisation en filières de production appuyées sur une organisation de grandes coopératives qui émergent en partie face au retrait dans les années 1960 de capitaux privés internationaux. Les coopératives soutiennent les exploitations familiales en mutualisant les achats nécessaires à la mécanisation et la recherche de débouchés, mais elles les rendent aussi plus dépendantes d’un environnement mondialisé. L’extension en taille de ces coopératives, certaines atteignant un rang mondial, et les liens croissants qui se nouent dans les années 1970 avec l’industrie agro-alimentaire insèrent encore plus l’exploitation agricole bretonne dans un système de contraintes à l’amont et à l’aval de l’activité.
Gouvernement régional et verrous socio-politiques
Sur un plan institutionnel et politique, cette modernisation agricole de l’après-guerre repose sur un système néocorporatiste2 dit de « cogestion » qui associe l’Etat, promoteur de cette dimension industrielle, et les acteurs professionnels du monde agricole, à qui est déléguée la mise en œuvre sur le terrain, au plus près des exploitations. Ces acteurs deviennent indispensables pour assurer la formation, l’encadrement et l’appui technique aux agriculteurs, via les chambres d’agriculture et les conseillers agricoles, mais aussi pour aider à la gestion foncière et financière du renouveau industriel de l’agriculture. Dans ce système néocorporatiste, la profession agricole est organisée et représentée par un syndicat majoritaire (la FNSEA) qui reste jusque dans les années 1980 la seule organisation reconnue par l’Etat, et demeure largement dominante jusqu’à aujourd’hui en Bretagne. Le modèle breton repose aussi sur des réseaux militants antérieurs, comme ceux de la JAC (Jeunesse Agricole Catholique) qui a joué un rôle de formation de nombreux cadres syndicaux et professionnels. Ce modèle a donc une dimension culturelle, avec des représentations largement partagées sur ce que doit être une agriculture moderne rendue efficiente par l’industrialisation, l’accroissement de la taille des exploitations, l’insertion dans les marchés mondiaux. La force de ces représentations est aussi ce qui empêche de penser une transition de rupture hors de ce cadre : les effets de pression sociale du voisinage sont documentés comme des obstacles au passage à l’agriculture biologique. Une enquête journalistique récente a même alerté sur les manifestations les plus brutales de cette pression qui vise à maintenir le modèle dominant3.
La force de ce référentiel tient aussi à son portage par une coalition défendant les intérêts politiques et économiques de la région, et son développement. Ce type d’alliance s’incarne très tôt dans des instances comme le CELIB (Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons, 1950) dont la modernisation agricole, avec l’industrialisation, est un des credo. L’héritage de la cogestion en Bretagne s’incarne aujourd’hui par le poids politique des représentants de la profession agricole, leur forte insertion dans les instances de planification, de concertation et dans l’administration régionale, celle-ci disposant des compétences principales dans ce secteur, avec la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC). Ce poids explique aussi les orientations prises dans plusieurs politiques sectorielles (eau, alimentation) et la prépondérance des intérêts agro-industriels dans ces dossiers : évolutions incrémentales destinées à contenir plus qu’à résoudre les problèmes de santé publique et d’environnement liés aux pollutions agricoles de l’eau4; recadrage de démarches comme BreiZhAlim pour privilégier le « local » sur la qualité alimentaire, mettant à l’écart les acteurs de l’agriculture biologique5.

Photo 1 : Session du Conseil Régional de Bretagne du 10/10/2024 à l’Hôtel de Courcy, Rennes, © Thomas Crabot – Région Bretagne
Lever les verrous pour une transformation systémique
Des initiatives pionnières, individuelles et en petits collectifs, ont pris depuis une quarantaine d’années des formes variées (gestion des prairies, agriculture régénératrice6, agriculture de conservation des sols7). Plus récemment des expérimentations territoriales d’une agriculture de transition (de type animation de bassin versant, MAEC8 Sol – semis direct, ou Terres de liens…) offrent des pistes mais posent la question de leur passage à l’échelle, face à plusieurs obstacles : concurrence du modèle dominant pour l’accès aux ressources (foncières, débouchés, etc.) ; attachement à un modèle industriel productiviste; freins aux changements individuels (risques économiques, besoins de formation) et collectifs (pressions politiques, impératifs à court terme de l’emploi).
Les nombreuses propositions avancées pour assurer la transformation agricole9 offrent des solutions applicables en Bretagne. De façon convergente, on retrouve la mise en œuvre d’une forme de compensation ou de paiement aux agriculteurs pour répondre aux exigences d’une transition juste et acceptable face aux surcoûts liés à l’atténuation des émissions. Ce dispositif doit encourager l’emploi par une attribution individuelle plutôt qu’à l’hectare, pour résister à la forte tendance actuelle d’une accumulation foncière et capitalistique. Une deuxième piste évoquée de façon récurrente est de profiter du renouvellement massif des générations pour orienter résolument l’installation de nouveaux exploitants vers une agriculture agro-écologique y compris l’Agriculture Biologique. Cela implique aussi une synergie entre financements privés et publics, une cohérence entre les politiques agricoles, de sécurité alimentaire et de réponse au changement climatique pour soutenir les démarches innovantes.
En termes de gouvernance, le Haut Conseil pour le Climat souligne, dans son rapport thématique sur l’agriculture10, l’influence des acteurs professionnels dominants et des industries agro-alimentaires sur la fabrique et la mise en œuvre des politiques publiques. A la lumière de ces constats, la clé d’une évolution systémique réside aussi dans une meilleure prise en compte de la diversité des intérêts agricoles, qui rompe avec l’héritage du système unitaire de la cogestion. L’adaptation de l’agriculture bretonne au changement climatique rend encore plus nécessaire la levée de ce verrou. Les changements structurels à faire advenir passent par une reconfiguration durable des coalitions d’acteurs qui interviennent dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques agricoles. Préparer un futur résilient nécessite un plus grand pluralisme dans la gouvernance de l’agriculture, qui doit associer tous les professionnels concernés et la société civile.
Titre : Verrous et leviers systémiques de l’agriculture bretonne
Auteur : Haut Conseil Breton pour le Climat
Année de publication : 2025
Type : Rapport
Citation : HAUT CONSEIL BRETON POUR LE CLIMAT, 2025, « Verrous et leviers systémiques de l’agriculture bretonne », Bulletin annuel 2025, p. 33-35
- Canévet, C. (1992). Le modèle agricole breton : histoire et géographie d’une révolution agro-alimentaire, Presses universitaires de Rennes. ↩︎
- Szarka J, 2000,.https://doi.org/10.1080/09644010008414539 ↩︎
- Legendre N, 2023, Silence dans les champs. Ed. Arthaud. ↩︎
- Bourblanc M, 2019, L’agriculture à l’épreuve de l’environnement, Trente ans de lutte pour la qualité des eaux en Bretagne, L’Harmattan, Paris ↩︎
- Pahun J, 2021. https://shs.cairn.info/revue-pole-sud-2021-2-page-19?lang=fr ↩︎
- Coulardeau et al, 2022. https://doi.org/10.17180/a9gx-mx72 ↩︎
- Roocks et al, 2016. https://doi.org/10.17180/1zjj-nf03 ↩︎
- https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/les-maec-et-aides-a-l-agriculture-biologique-campagne-2024-a3418.html ↩︎
- France Stratégie, 2019, https://www.strategie.gouv.fr/files/files/Publications/Rapport/fs-rapport-pac-octobre-2019.pdf ↩︎
- Haut Conseil pour le Climat, 2024, op. cit. ↩︎